 Or donc, la Suisse romande a enterré, mercredi, à Lausanne, son grand écrivain. L'air était glacial, la foule, nombreuse. La cérémonie, austère et solennelle, collait bien à l'image que Jacques Chessex s'est construite toute sa vie : celle d'une homme grave, solitaire, tourmenté. Dans ce sens-là, elle fut fidèle. Peu de discours, si l'on excepte le bel hommage de Jérôme Garcin. Un sermon retenu. Des orgues discrètes.
Or donc, la Suisse romande a enterré, mercredi, à Lausanne, son grand écrivain. L'air était glacial, la foule, nombreuse. La cérémonie, austère et solennelle, collait bien à l'image que Jacques Chessex s'est construite toute sa vie : celle d'une homme grave, solitaire, tourmenté. Dans ce sens-là, elle fut fidèle. Peu de discours, si l'on excepte le bel hommage de Jérôme Garcin. Un sermon retenu. Des orgues discrètes.
Avec Jacques Chessex, la littérature romande perd sans doute ce que Dominique Noguez nomme ironiquement — mais affectueusement — un grantécrivain* (en un mot). Qu'est-ce qu'un grantécrivain ? Un écrivain accompli qui vit pour et par l'écriture. Qui écrit tout le temps et publie beaucoup (J.C. a publié plus de 60 livres !). Qui plus est à Paris, la ville lumière, dans l'une des plus prestigieuses maisons d'édition françaises, Grasset, qui publia Céline, Giraudoux, Nourissier, etc. Un écrivain couvert de Prix et de récompenses (la vie de J.C. a été transfigurée par le Goncourt de 1973, le premier et sans doute le seul Goncourt du roman décerné à un écrivain suisse). Et, comme si cela ne suffisait pas, un écrivain à succès (son dernier livre, Un Juif pour l'exemple, s'est vendu à 30'000 exemplaires).
Ne chipotons pas, comme d'autres, sur les menus défauts de l'homme. Ce serait ridicule, puisqu'un grantécrivain n'est pas un homme comme les autres. Il est admiré, détesté, attaqué, adulé et traîné dans la boue. Il reçoit chaque jour des mots doux et des lettres de menace. Chacun de ses gestes est épié, guetté, photographié ; chacune de ses paroles analysée longuement. Bref, un grantécrivain quitte le silence obligé et l'anonymat des artisans de l'ombre : il devient une figure publique. Les journaux l'adorent ou le descendent en flammes. Son éditeur le tient au chaud. Même la télévision s'intéresse à lui, consécration suprême de la société de spectacle.
On le voit : J.C. était notre seul grantécrivain. Le seul dont les paroles, répercutées tous azimuts par les média, avaient valeur d'oracle. Il en a profité et il s'en est bien amusé. D'autant qu'à ses débuts, cette même presse ne l'a pas épargné. Davantage qu'un Haldas (que les critiques ignorent), qu'un Chappaz (classé « écrivain régionaliste »), qu'un Jaccottet (poète trop raffiné), voire même qu'un Bouvier (rangé dans le tiroir des « écrivains voyageurs »), Chessex a été sacré de son vivant, ce qui est rare, à la fois pour son œuvre et son sacré caractère. Ce fut le seul à défendre très au-delà des frontières les auteurs romands qu'il appréciait, comme Gustave Roud, Mercanton, Chappaz encore, Corina Bille et beaucoup d'autres.
Comme le disait Jérôme Garcin, mercredi, à Lausanne : « il ne faut pas pleurer Jacques Chessex, il faut le lire. »
* Dominique Noguez, Le Grantécrivain et autres textes, Gallimard, 2000.
 On l'oublie trop souvent : écrire est difficile, incertain, périlleux, angoissant — surtout en Suisse romande où tout conspire à étouffer les voix qui pourraient être singulières. Les exemples ne manquent pas d'écrivains étranglés par le silence ou l'indifférence. Adrien Pasquali était de ceux-là. Il y a dix ans, le 23 mars 1999, à Paris, il a décidé de se donner la mort, et d'abandonner les siens. Jérôme Meizoz, qui l'a bien connu, lui adresse, dix ans plus tard, de belles lettres, qu'on peut lire
On l'oublie trop souvent : écrire est difficile, incertain, périlleux, angoissant — surtout en Suisse romande où tout conspire à étouffer les voix qui pourraient être singulières. Les exemples ne manquent pas d'écrivains étranglés par le silence ou l'indifférence. Adrien Pasquali était de ceux-là. Il y a dix ans, le 23 mars 1999, à Paris, il a décidé de se donner la mort, et d'abandonner les siens. Jérôme Meizoz, qui l'a bien connu, lui adresse, dix ans plus tard, de belles lettres, qu'on peut lire 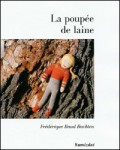 Il y a des livres qui nous hantent parce qu’ils sont justes, parce qu’ils touchent à l’essentiel de notre condition humaine. La Poupée de laine* de Frédérique Baud Bachten est de ceux-là. Avec cette première publication aux éditions Samizdat, l’auteure renoue avec son expérience du théâtre et de la radio. Elle évoque le tragique destin d’un enfant, né pas comme les autres, tourmenté par un mal sans nom, mettant en péril le fragile équilibre de ceux qui l’aiment avec une volonté peu commune. Doris Lessing avec le Cinquième Enfant **, Siri Hustvedt avec Tout ce que j’aimais***, et tout récemment, Jean-Louis Fournier avec Où on va, papa ? ****, ont abordé la douloureuse question de la filiation de la différence, une différence qui parfois peut s’apparenter au diable en personne. Doit-on se sentir coupable d’avoir engendré le pire ? Pourquoi le mal s’incarne-t-il dans un enfant, fruit de l’amour et du bonheur sans limite ? Suffit-il de comprendre l’héritage ambivalent que nous lèguent nos ancêtres, d’en analyser la part vénéneuse, afin de chasser la cruauté du destin ? La Poupée de laine est peut-être une tentative de réponse — les enfants ne nous appartiennent pas — mais aussi le récit d’une possibilité de pardon.
Il y a des livres qui nous hantent parce qu’ils sont justes, parce qu’ils touchent à l’essentiel de notre condition humaine. La Poupée de laine* de Frédérique Baud Bachten est de ceux-là. Avec cette première publication aux éditions Samizdat, l’auteure renoue avec son expérience du théâtre et de la radio. Elle évoque le tragique destin d’un enfant, né pas comme les autres, tourmenté par un mal sans nom, mettant en péril le fragile équilibre de ceux qui l’aiment avec une volonté peu commune. Doris Lessing avec le Cinquième Enfant **, Siri Hustvedt avec Tout ce que j’aimais***, et tout récemment, Jean-Louis Fournier avec Où on va, papa ? ****, ont abordé la douloureuse question de la filiation de la différence, une différence qui parfois peut s’apparenter au diable en personne. Doit-on se sentir coupable d’avoir engendré le pire ? Pourquoi le mal s’incarne-t-il dans un enfant, fruit de l’amour et du bonheur sans limite ? Suffit-il de comprendre l’héritage ambivalent que nous lèguent nos ancêtres, d’en analyser la part vénéneuse, afin de chasser la cruauté du destin ? La Poupée de laine est peut-être une tentative de réponse — les enfants ne nous appartiennent pas — mais aussi le récit d’une possibilité de pardon.